Podcast: Play in new window | Download
S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More
L’invité: Eric Fournier, maître de conférences à l’Université Paris-I
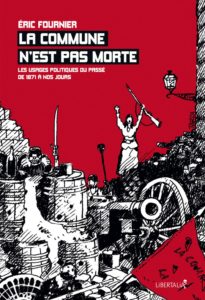 L’événement et le livre: 150e anniversaire de la Commune / La Commune n’est pas morte! Usages politiques du passé de 1871 à nos jours, Libertalia, 2013.
L’événement et le livre: 150e anniversaire de la Commune / La Commune n’est pas morte! Usages politiques du passé de 1871 à nos jours, Libertalia, 2013.
La discussion:
- Une commémoration sous Covid en mode mineur pour 2021 (1:30)
- Les premières commémorations de 1880-1881 (2:50)
- La naissance du “mur des fédérés” (5:00)
- Commémorer ailleurs? (7:20)
- Les bolcheviks et la Commune (9:35)
- Le cinquantenaire de la Commune au temps de la division SFIC-PCF / SFIO (12:15)
- Les lectures réductrices de la Commune dans la mémoire communiste (15:40)
- Une mémoire plus unie au temps du Front Populaire (19:30)
- La Commune, hantise de Weygand en 1940 (22:05)
- Doriot et la Commune (24:35)
- Mai 68, réactivation de la Commune (28:00)
- Un centenaire politisé et conflictuel en 1971 (29:15)
- Pourquoi Pompidou n’était pas au Mur des Fédérés lors du centenaire (30:30)
- Une mémoire qui tend à se banaliser depuis les années 1980 (32:50)
- La réactivation de discours “Versaillais” dans les années 2000 (34:40)
- Les enjeux politiques de la commémoration en 2021 (36:10)
Les conseils et références citées dans l’émission (par ordre alphabétique) :
- Marc César, Laure Godineau (dir.), La Commune de 1871 : une relecture, Grane, Créaphis, 2019.
- Jordi Brahamcha-Marin et Alice De Charentenay, La Commune des écrivains. Paris, 1871 : vivre et écrire l’insurrection, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2021.
- Michel Cordillot, La Commune 1871 (collection Maitron)
- Quentin Deluermoz, Commune(s). Une traversée des mondes au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2020.
- Madeleine Rébérioux, “Le mur des fédérés”, in P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire.
- Jacques Rougerie, Procès des Communards, Paris, Julliard, coll. « Archives », 1964.
- Edith Thomas, Les pétroleuses, Paris, Gallimard, “Folio histoire”, 2021 [1964], préface de Chloé Leprince.


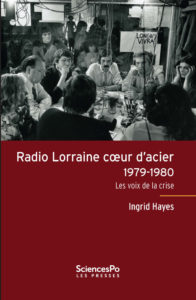
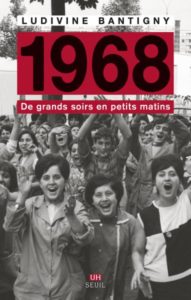 La discussion : les bornes chronologiques de l’événement « 68 » (à 3 minutes d’entretien environ), la violence des manifestations et de la répression menant aux « morts oubliés » de juin 1968 (6 min.),l’importance pour l’historienne de restituer la dimension matérielle et concrète de l’événement (10 min), le rapport au passé (le Front Populaire, la Commune…) en mai-juin 1968 (15 min.), l’internationalisme pensé et vécu par les acteurs du mouvement (18 min.), le rapport aux sources et le travail en archives sur les fiches établies par la police (22 min.), la mémoire spécifique de la guerre d’Algérie et la présence (ou non) de « Charonne » et du 17 octobre 1961 dans les esprits en 1968 (25 min.), les rapports hommes-femmes, la difficile prise de parole féminine, et la question de la sexualité (27 min.), une histoire contrefactuelle de mai-juin 1968 : comment les choses auraient-elles pu tourner autrement, basculer ? Quel rôle pour la CGT en particulier ? (32 min.), quels acquis sociaux, alors que l’inflation rend éphémères les gains salariaux, et qu’à l’échelle locale les rapports de force sont souvent défavorables aux grévistes après « mai » ? (38 min.), que font les historiennes et les historiens en mai 68 ? (40 min.).
La discussion : les bornes chronologiques de l’événement « 68 » (à 3 minutes d’entretien environ), la violence des manifestations et de la répression menant aux « morts oubliés » de juin 1968 (6 min.),l’importance pour l’historienne de restituer la dimension matérielle et concrète de l’événement (10 min), le rapport au passé (le Front Populaire, la Commune…) en mai-juin 1968 (15 min.), l’internationalisme pensé et vécu par les acteurs du mouvement (18 min.), le rapport aux sources et le travail en archives sur les fiches établies par la police (22 min.), la mémoire spécifique de la guerre d’Algérie et la présence (ou non) de « Charonne » et du 17 octobre 1961 dans les esprits en 1968 (25 min.), les rapports hommes-femmes, la difficile prise de parole féminine, et la question de la sexualité (27 min.), une histoire contrefactuelle de mai-juin 1968 : comment les choses auraient-elles pu tourner autrement, basculer ? Quel rôle pour la CGT en particulier ? (32 min.), quels acquis sociaux, alors que l’inflation rend éphémères les gains salariaux, et qu’à l’échelle locale les rapports de force sont souvent défavorables aux grévistes après « mai » ? (38 min.), que font les historiennes et les historiens en mai 68 ? (40 min.).