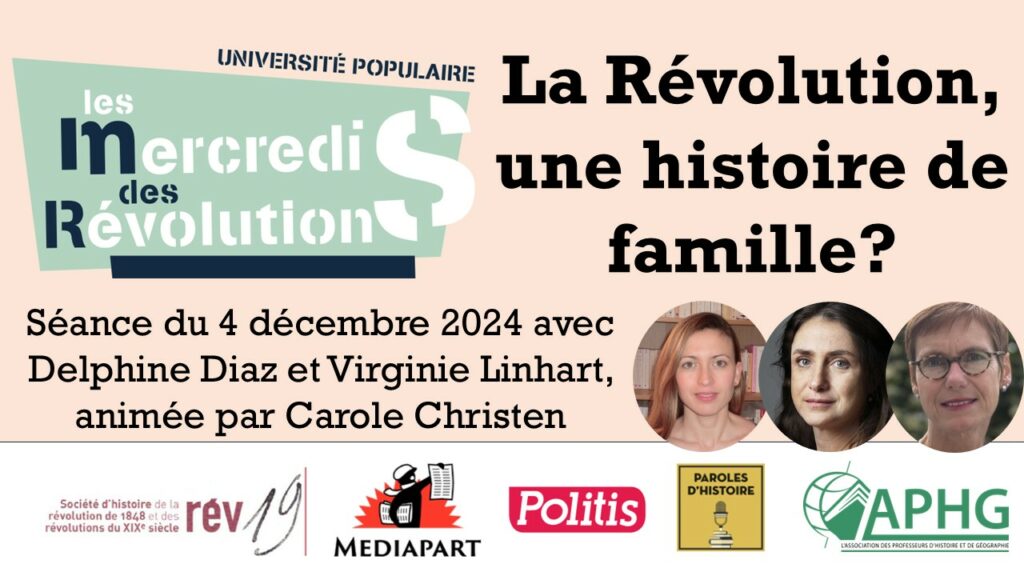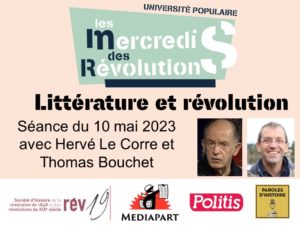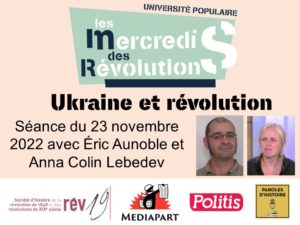Podcast: Play in new window | Download
S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | | More
Première séance pour la 7e saison des “mercredis des révolutions”, l’Université populaire de la société d’histoire de 1848 à la mairie du XVIIIe arrondissement de Paris, en partenariat avec Mediapart, Politis et Paroles d’histoire.
La question climatique est devenue obsédante, recouvrant de son ombre les innombrables crises écologiques qui caractérisent la période contemporaine, et ouvrant sur une ère d’instabilités et d’incertitudes politiques et sociales. Le surgissement de la question environnementale met à mal les découpages politiques habituels, rythmés par les évènements révolutionnaires, tout en invitant à repenser ces derniers. L’exploitation accrue de la nature est contemporaine des grandes révolutions atlantiques de la fin du 18e siècle et des transformations qu’elles induisent dans le droit et le fonctionnement de l’État, elle ouvre des bouleversements qu’on peut à bon droit penser comme révolutionnaires.
Aujourd’hui, alors que les questions écologiques ont envahi les champs intellectuel et politique, façonnant des langages et des répertoires d’action protestataires– pensons au rôle des ZAD et aux luttes autour des infrastructures comme celles des Soulèvements de la terre ou d’Extinction Rebellion – de plus en plus de travaux se tournent vers l’écologie des révolutions et tentent de (re)penser les liens qui relient les dynamiques révolutionnaires et environnementales, hier comme aujourd’hui.
La prise en compte des enjeux écologiques éclaire en effet les expériences révolutionnaires qui, en retour, sont souvent des moments décisifs de réagencement de ce qu’on nomme “nature” et “société”. Ces questions retiennent de plus en plus l’attention et invitent à questionner comment les révolutions déstabilisent les représentations dominantes de la nature et remodèlent les partages nature/artifice ? Comment les discours politiques mobilisent les entités naturelles et les êtres vivants ? Comment les dynamiques révolutionnaires remodèlent l’écologie des sociétés ? Mais aussi comment l’essor de l’histoire environnementale invite à relire et questionner les dynamiques révolutionnaires ? Dans quelle mesure l’essor des luttes écologiques contemporaines peut-il être considéré comme révolutionnaire ?
Séance enregistrée le 10 janvier 2024, animée par François Jarrige (MCF, université de Bourgogne)
Anne-Claude Ambroise-Rendu, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et auteure de Une histoire des luttes pour l’environnement – XVIIIe-XXe siècles trois siècles de débats et de combats (avec Steve Hagimont, Charles-François Mathis et Alexis Vrignon, Textuel, 2021), et de Une histoire des conflits environnementaux, luttes locales, enjeu global, (dir. avec Anna Trespeuch-Berthelot et Alexis Vrignon, Limoges, Pulim, 2018) ;
Jade Lindgaard, journaliste à Mediapart. Elle enquête notamment sur les injustices environnementales, les pollutions industrielles et a publié plusieurs livres sur ces enjeux dont : Eloge des mauvaises herbes. Ce que nous devons à la ZAD (Les Liens qui libèrent, 2018), Je crise climatique. La Planète, ma chaudière et moi (La Découverte, 2014).