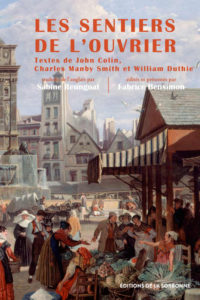L’invitée : Clyde Plumauzille, chargée de recherches au CNRS, membre du LabEx EHNE
Le livre : Prostitution et révolution. Les femmes publiques dans la cité républicaine (1789-1804), Paris, Champ Vallon, 2016.
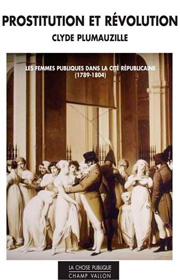 La discussion : un état des lieux de l’univers prostitutionnel à Paris à la veille de la Révolution, et son cadre légal contraignant (2’), la place spécifique de la prostitution dans les cahiers de doléances (4’45), les caractéristiques sociales des femmes arrêtées comme prostituées sous la Révolution (5’50) et l’importance méthodologique de ne pas réifier la catégorie « prostituées », d’envisager un « continuum de pratiques » (6’50), une filiation historiographique qui n’est pas seulement celle d’Alain Corbin, mais aussi de Jill Harsin, pour en faire une histoire sociale (9’30), l’intégration de l’histoire de la prostitution dans une histoire du travail (10’50), comment combiner une “agency” (capacité d’agir) de ces femmes, avec l’existence de contraintes et de dominations (13’), l’univers social dans lequel évoluent ces femmes, avec des clients / amants / amis / souteneurs (ces derniers assez rares) (14’55), la source très rare que constitue le journal d’Alexandre Brongniart racontant ses relations avec des prostituées (17’30), le Palais-Royal comme lieu central de la prostitution sous la Révolution (18’30), les plaintes des riverains attestant d’une « lutte des places » parmi les classes populaires dans l’espace urbain (20’30), le contrôle policier adossé à une crainte des maladies vénériennes (22’30), le paradoxal silence des législateurs révolutionnaires sur la prostitution, avec une dépénalisation silencieuse (24’35), un tournant hostile à la prostitution et plus largement aux femmes dans l’espace public en 1793 (27’50), une distinction entre droit de cité et droit à la cité qui montre la citoyenneté « diminuée » de femmes désignées comme prostituées, encore vérifiable aujourd’hui (31’), face à ces contraintes, la ressource de l’écriture, pour des femmes incarcérées après la Terreur (33’45).
La discussion : un état des lieux de l’univers prostitutionnel à Paris à la veille de la Révolution, et son cadre légal contraignant (2’), la place spécifique de la prostitution dans les cahiers de doléances (4’45), les caractéristiques sociales des femmes arrêtées comme prostituées sous la Révolution (5’50) et l’importance méthodologique de ne pas réifier la catégorie « prostituées », d’envisager un « continuum de pratiques » (6’50), une filiation historiographique qui n’est pas seulement celle d’Alain Corbin, mais aussi de Jill Harsin, pour en faire une histoire sociale (9’30), l’intégration de l’histoire de la prostitution dans une histoire du travail (10’50), comment combiner une “agency” (capacité d’agir) de ces femmes, avec l’existence de contraintes et de dominations (13’), l’univers social dans lequel évoluent ces femmes, avec des clients / amants / amis / souteneurs (ces derniers assez rares) (14’55), la source très rare que constitue le journal d’Alexandre Brongniart racontant ses relations avec des prostituées (17’30), le Palais-Royal comme lieu central de la prostitution sous la Révolution (18’30), les plaintes des riverains attestant d’une « lutte des places » parmi les classes populaires dans l’espace urbain (20’30), le contrôle policier adossé à une crainte des maladies vénériennes (22’30), le paradoxal silence des législateurs révolutionnaires sur la prostitution, avec une dépénalisation silencieuse (24’35), un tournant hostile à la prostitution et plus largement aux femmes dans l’espace public en 1793 (27’50), une distinction entre droit de cité et droit à la cité qui montre la citoyenneté « diminuée » de femmes désignées comme prostituées, encore vérifiable aujourd’hui (31’), face à ces contraintes, la ressource de l’écriture, pour des femmes incarcérées après la Terreur (33’45).
Les références citées dans le podcast :
– Gérard Noiriel, Introduction à la socio-histoire, Paris, La découverte », « Repères », 2006.
– Alain Corbin, Les filles de noce, Misère sexuelle et prostitution (XIXe et XXe siècles), Paris, Aubier Montaigne, 1978.
– Jill Harsin, Policing Prostitution in Nineteenth Century Paris, Princeton, Princeton University Press, 1985
– Arlette Farge, La vie fragile, violences, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1986.
– Anne Simonin, Le déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité 1791-1958, Paris, Grasset, 2008.
-Emmanuel Blanchard, La police parisienne et les Algériens (1944-1962), Paris, éd. Nouveau monde, 2011, 448 p.
Le conseil de lecture : Park Mun-wung, Mémoires d’un frêne, d’après une nouvelle de Choi Yong-tak, Rue de l’échiquier, 2018.