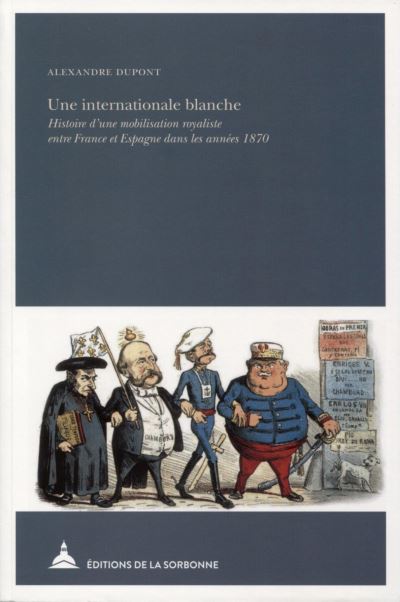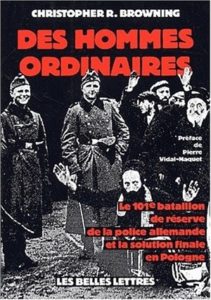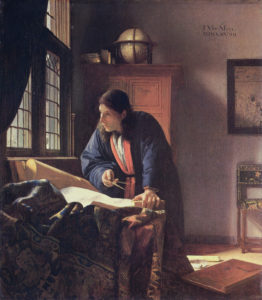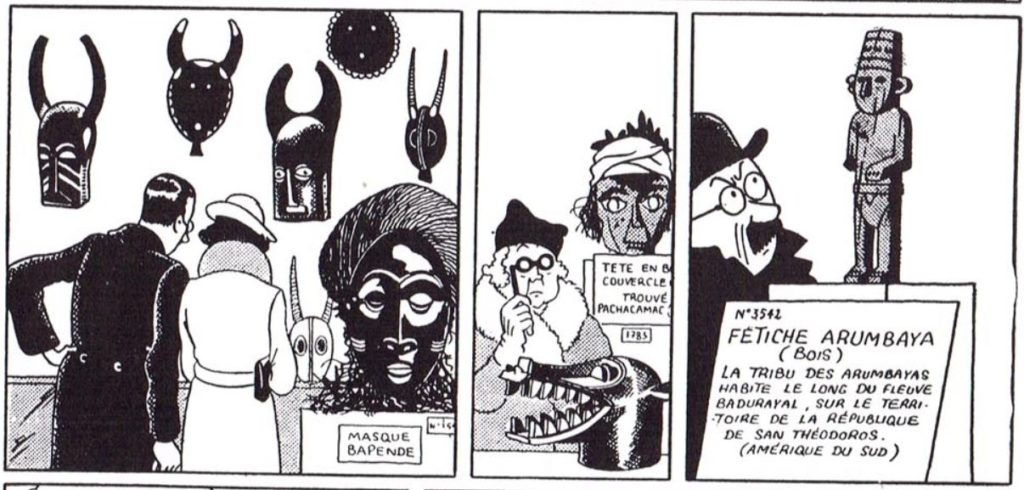Podcast: Play in new window | Download
S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More
L’invitée : Christiane Klapisch-Zuber directrice d’études honoraire à l’EHESS
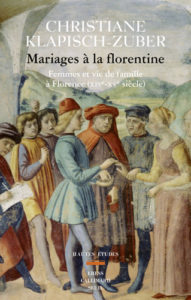 Le livre : Mariages à la florentine. Femmes et vie de famille à Florence (XIVe-XVe siècle), Paris, EHESS / Gallimard / Seuil, coll. « Hautes études », 2020.
Le livre : Mariages à la florentine. Femmes et vie de famille à Florence (XIVe-XVe siècle), Paris, EHESS / Gallimard / Seuil, coll. « Hautes études », 2020.
La discussion :
- Un parcours de recherche orienté par Fernand Braudel, de l’histoire économique et sociale vers l’anthropologie historique (1’10)
- Un travail fondamental sur le catasto florentin (3’20)
- Les gisements documentaires extraordinaires de la ville (4’15)
- L’accès aux familles patriciennes comme à des couches sociales plus modestes (5’)
- Contrastes et différences entre Florence et Venise (6’15)
- Le recueil d’articles construit comme un livre ordonné, montrant la vie des femmes mariées (8’20)
- La notion de « marché matrimonial » à Florence au XVe siècle (9’25)
- Les calculs familiaux, destinés à marier ou à vouer à l’Église certains enfants (10’40)
- Des mariages célébrés devant le notaire, plus que devant l’Église (13’30)
- La dot, clé des relations sociales et matrimoniales (15’15)
- Le sens à donner aux images de femmes parées et habillées, dans l’iconographie (18’15)
- Les choix des épouses par leurs futures belles-mères (20’30)
- Les cycles de vie particuliers des marchands florentins (23’)
- La chambre nuptiale, ses objets, ses représentations (24’45)
- Le nombre de naissances, l’importance de la mortalité infantile (27’50)
- Quels sentiments familiaux, envers les enfants ? (30’)
- Quel statut pour une veuve, et son « matrimoine » dans la société florentine ? (32’)
- Quelle transmission du nom par les femmes ? (35’40)
- La sépulture des femmes et ses enjeux (37’30)
- Que voir, à Florence, comme traces de cette histoire ? (39’)
Entretien avec Didier Lett retraçant la carrière de Christiane Klapisch-Zuber
Bibliographie et références citées dans l’émission
- Bellavitis, Anna, « Dot et richesse des femmes à Venise au XVIe siècle », Clio, HFS, 6, 1998, p. 91-100.
- Chabot, Isabelle, La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles, Ecole française de Rome, 2011, coll. de l’EFR 445.
- Chabot, Isabelle & Anna Bellavitis, « A proposito di ‘Men and Women in Renaissance Venice’ di Stanley Chojnacki », Quaderni storici, 2005, p. 203-238.
- Frugoni, Chiara, Une journée au Moyen âge, Paris, Les Belles lettres, 2013.
- Guglielmotti, Paola (dir.), Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XII, Gênes, Società Ligure di storia patria, 2020.
- Kirshner, Julius, « Pursuing honor while avoiding sin. The Monte delle doti of Florence », Milano, Giuffrè, 1977.
- Lett, Didier, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe s.), Paris, Aubier, 1997.
- Molho, Anthony, Marriage alliance in late medieval Florence, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1994.
Texte de Dante cité à la fin de l’émission
Dante Alighieri, La divine comédie, t. III, Le Paradis, chant XV, v. 97-108, Paris, Flammarion, 1990, trad. Jacqueline Risset. Dante rencontre son trisaïeul Cacciaguida qui lui loue l’état de Florence au XIIe siècle :
« Florence en son antique enceinte
où elle sonne encore la tierce et la none,
était en paix, sobre et pudique.
Elle n’avait ni habits brodés ni ceinture
qui fussent plus à voir que la personne.
La fille, en naissant, ne faisait pas encore
peur à son père, car l’âge et la dot
ne dépassaient ni l’un ni l’autre la mesure.
Elle n’avait pas de maison sans familles,
on n’y rencontrait pas encore Sardanapale,
pour montrer ce qui est permis en la chambre. »
Inscription citée à la fin de l’émission
Epitaphe, Florence, Santa Maria Novella
« Heic jacet in requie Domini/ Septima puella ornatissima/ ***mi de Rubeis Melocchiis patr. pist. eq. Steph./ et Felicis Mazzettiae flor. f. /quae virile ingenium studio adepta/ annum agens secundum supra vigesimum/ diuturna hidatidi abdominali ingruente/dum ferrum a quo spes erat salutis/ sensit in sui perniciem conversum/ constans animi et religione potens/ e vita migravit/ III non. Octob. a. r. s. CIϽIϽCCCVII »
Traduction : « Ici repose dans le Seigneur la septième fille très distinguée de ****mo dei Rossi Melocchi son père, chevalier pistoiais de [l’ordre de] Saint-Etienne, et de Felice Mazzetti de Florence, laquelle — ayant acquis par l’étude une intelligence virile, [mais] attaquée à l’âge de vingt-deux ans par une hytadis (infection ?) abdominale persistante, quand le fer où résidait l’espoir de son salut devint sa perte — quitta cette vie le 3 des nones d’octobre 1807. »
*NB : inscription partiellement illisible