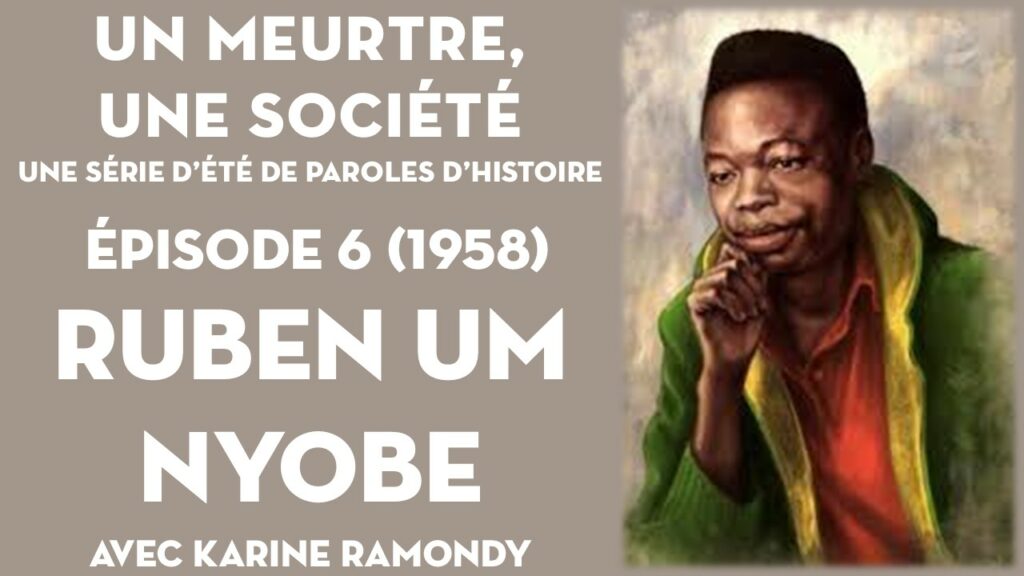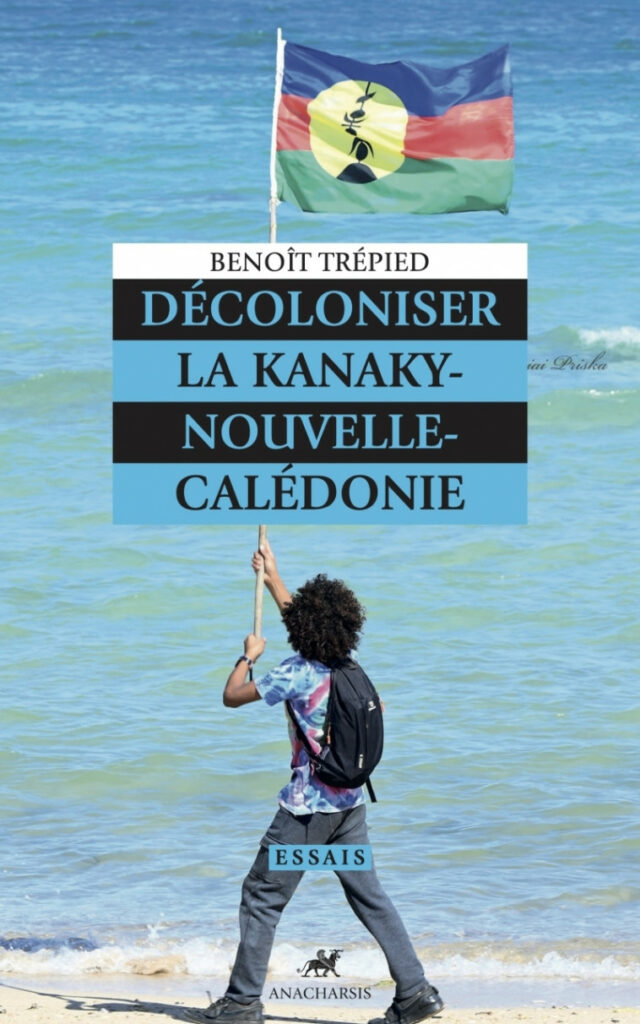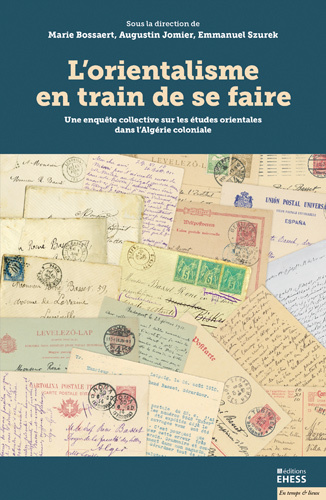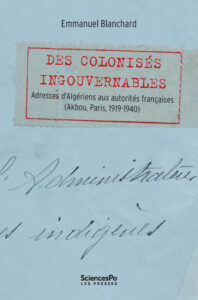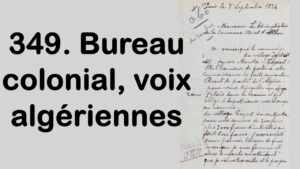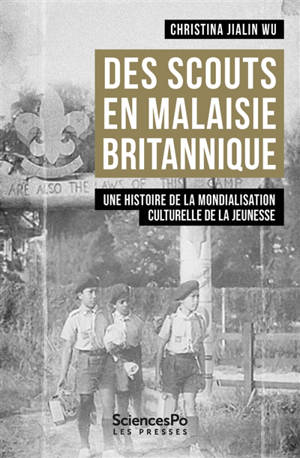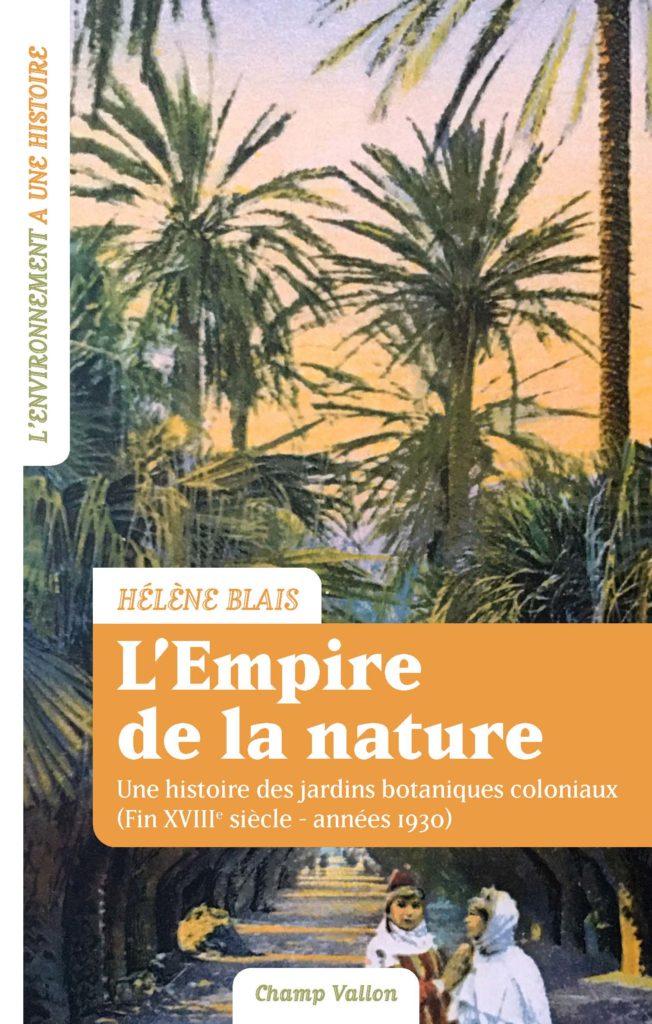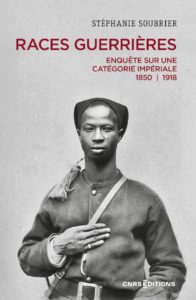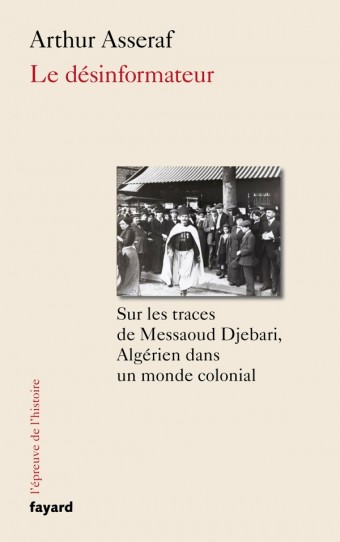L’invité : Benoît Trépied, anthropologue au CNRS
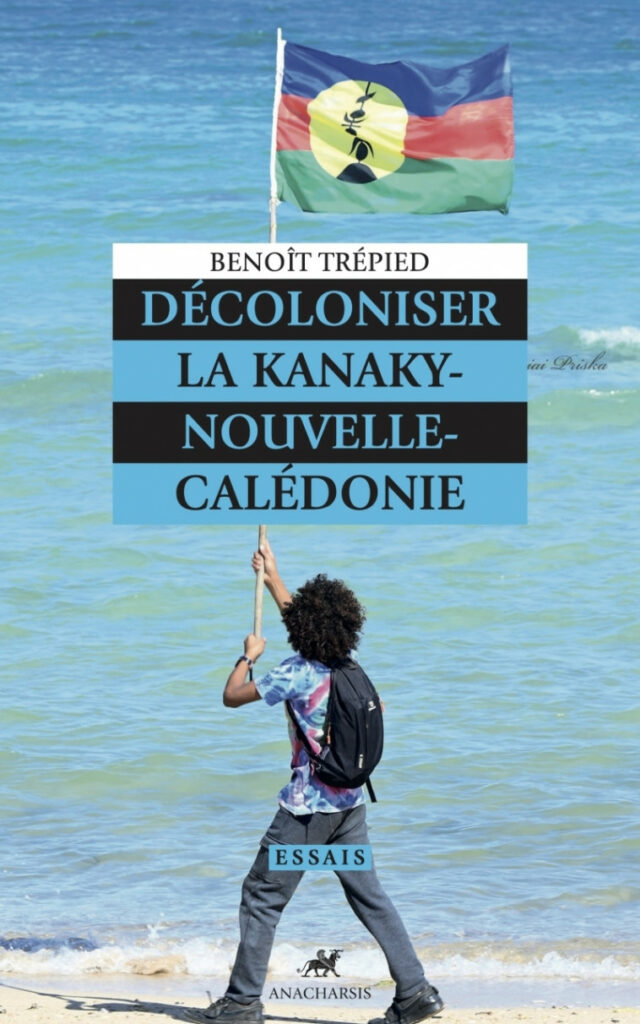
Le livre : Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, Paris, Anacharsis, 2025.
La discussion :
- Les origines du livre et du travail sur la Kanaky-Nouvelle-Calédonie (00:00)
- Sur place, l’histoire coloniale n’est pas du passé (6:50)
- La période coloniale à partir de 1853 : colonie carcérale et de peuplement (11:30)
- Les logiques raciales, spatiales, répressives de la colonisation de peuplement (« settler colonialism ») (17:00)
- Le droit colonial qui crée des « tribus », des « chefs » et transforme la société kanak (24:15)
- Répartition numérique des groupes, métissage, enjeux démographiques passés et présents (30:15)
- Le tournant des années 1960-1970 et le « boom du Nickel » bouleversant les équilibres sociaux et les enjeux idéologiques (44:15)
- Les violences des années 1980, et les accords de compromis, Matignon 1988 et Nouméa 1998, fondés sur une reconnaissance de l’histoire coloniale (49:50)
- Le retour en arrière dramatique de la séquence 2020-2025 : déni de l’histoire coloniale, reniement de la parole donnée (1:00:30)
Conseils de lecture :
- Alice Zeniter, Frapper l’épopée, 2024.
- Nathan Thrall, Une journée dans la vie d’Abed Salama. Anatomie d’une tragédie à Jérusalem, 2024
Télécharger la transcription de l’émission : https://transcripts.blubrry.com/parolesdhistoire/143924353-52712.srt
Pour supprimer le minutage de la transcription utiliser cet outil en ligne : https://anatolt.ru/t/del-timestamp-srt.html
Annexe : préambule de l’accord de Nouméa
Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998
NOR : PRMX9801273X
JORF n°121 du 27 mai 1998
Préambule
- Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait dénommée « Nouvelle-Calédonie », le 24 septembre 1853, elle s’approprie un territoire selon les conditions du droit international alors reconnu par les nations d’Europe et d’Amérique, elle n’établit pas des relations de droit avec la population autochtone. Les traités passés, au cours de l’année 1854 et les années suivantes, avec les autorités coutumières, ne constituent pas des accords équilibrés mais, de fait, des actes unilatéraux.
Or, ce territoire n’était pas vide.
La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été dénommés kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur imaginaire s’exprimaient dans diverses formes de création.
L’identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de l’accueil d’autres familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d’entre eux, les chemins coutumiers structuraient l’espace et les échanges.
- La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s’est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d’Europe ont imposé leur domination au reste du monde.
Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre, aux xixe et xxe siècles, convaincus d’apporter le progrès, animés par leur foi religieuse, venus contre leur gré ou cherchant une seconde chance en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont installés et y ont fait souche. Ils ont apporté avec eux leurs idéaux, leurs connaissances, leurs espoirs, leurs ambitions, leurs illusions et leurs contradictions.
Parmi eux certains, notamment des hommes de culture, des prêtres ou des pasteurs, des médecins et des ingénieurs, des administrateurs, des militaires, des responsables politiques ont porté sur le peuple d’origine un regard différent, marqué par une plus grande compréhension ou une réelle compassion.
Les nouvelles populations sur le territoire ont participé, dans des conditions souvent difficiles, en apportant des connaissances scientifiques et techniques, à la mise en valeur minière ou agricole et, avec l’aide de l’Etat, à l’aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Leur détermination et leur inventivité ont permis une mise en valeur et jeté les bases du développement.
La relation de la Nouvelle-Calédonie avec la métropole lointaine est demeurée longtemps marquée par la dépendance coloniale, un lien univoque, un refus de reconnaître les spécificités, dont les populations nouvelles ont aussi souffert dans leurs aspirations.
- Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière.
Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d’origine.
Des clans ont été privés de leur nom en même temps que de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des déplacements considérables de population, dans lesquels des clans kanak ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères identitaires.
L’organisation sociale kanak, même si elle a été reconnue dans ses principes, s’en est trouvée bouleversée. Les mouvements de population l’ont déstructurée, la méconnaissance ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité selon la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire.
Simultanément, le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé.
À cette négation des éléments fondamentaux de l’identité kanak se sont ajoutées des limitations aux libertés publiques et une absence de droits politiques, alors même que les kanak avaient payé un lourd tribut à la défense de la France, notamment lors de la Première Guerre mondiale.
Les kanak ont été repoussés aux marges géographiques, économiques et politiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, chez un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes, aggravant les ressentiments et les incompréhensions.
La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu’elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d’une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun.
- La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d’établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps.
Les communautés qui vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l’édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et au fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Si l’accession des kanak aux responsabilités demeure insuffisante et doit être accrue par des mesures volontaristes, il n’en reste pas moins que la participation des autres communautés à la vie du territoire lui est essentielle.
Il est aujourd’hui nécessaire de poser les bases d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d’origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun.
La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et sociaux ne permettent pas d’ouvrir largement le marché du travail et justifient des mesures de protection de l’emploi local.
Les accords de Matignon signés en juin 1988 ont manifesté la volonté des habitants de Nouvelle-Calédonie de tourner la page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de paix, de solidarité et de prospérité.
Dix ans plus tard, il convient d’ouvrir une nouvelle étape, marquée par la pleine reconnaissance de l’identité kanak, préalable à la refondation d’un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de souveraineté avec la France, sur la voie de la pleine souveraineté.
Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L’avenir doit être le temps de l’identité, dans un destin commun.
La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie.
- Les signataires des accords de Matignon ont donc décidé d’arrêter ensemble une solution négociée, de nature consensuelle, pour laquelle ils appelleront ensemble les habitants de Nouvelle-Calédonie à se prononcer.
Cette solution définit pour vingt années l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation.
Sa mise en œuvre suppose une loi constitutionnelle que le Gouvernement s’engage à préparer en vue de son adoption au Parlement.
La pleine reconnaissance de l’identité kanak conduit à préciser le statut coutumier et ses liens avec le statut civil des personnes de droit commun, à prévoir la place des structures coutumières dans les institutions, notamment par l’établissement d’un Sénat coutumier, à protéger et valoriser le patrimoine culturel kanak, à mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques et financiers pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre, tout en favorisant sa mise en valeur, et à adopter des symboles identitaires exprimant la place essentielle de l’identité kanak du pays dans la communauté de destin acceptée.
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie traduiront la nouvelle étape vers la souveraineté : certaines des délibérations du Congrès du territoire auront valeur législative et un Exécutif élu les préparera et les mettra en œuvre.
Au cours de cette période, des signes seront donnés de la reconnaissance progressive d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant traduire la communauté de destin choisie et pouvant se transformer, après la fin de la période, en nationalité, s’il en était décidé ainsi.
Le corps électoral pour les élections aux assemblées locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes établies depuis une certaine durée.
Afin de tenir compte de l’étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l’accès à l’emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie.
Le partage des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera progressif. Des compétences seront transférées dès la mise en œuvre de la nouvelle organisation. D’autres le seront selon un calendrier défini, modulable par le Congrès, selon le principe d’auto-organisation. Les compétences transférées ne pourront revenir à l’État, ce qui traduira le principe d’irréversibilité de cette organisation.
La Nouvelle-Calédonie bénéficiera pendant toute la durée de mise en œuvre de la nouvelle organisation de l’aide de l’État, en termes d’assistance technique et de formation et des financements nécessaires, pour l’exercice des compétences transférées et pour le développement économique et social.
Les engagements seront inscrits dans des programmes pluriannuels. La Nouvelle-Calédonie prendra part au capital ou au fonctionnement des principaux outils du développement dans lesquels l’État est partie prenante.
Au terme d’une période de vingt années, le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations intéressées.
Leur approbation équivaudrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.