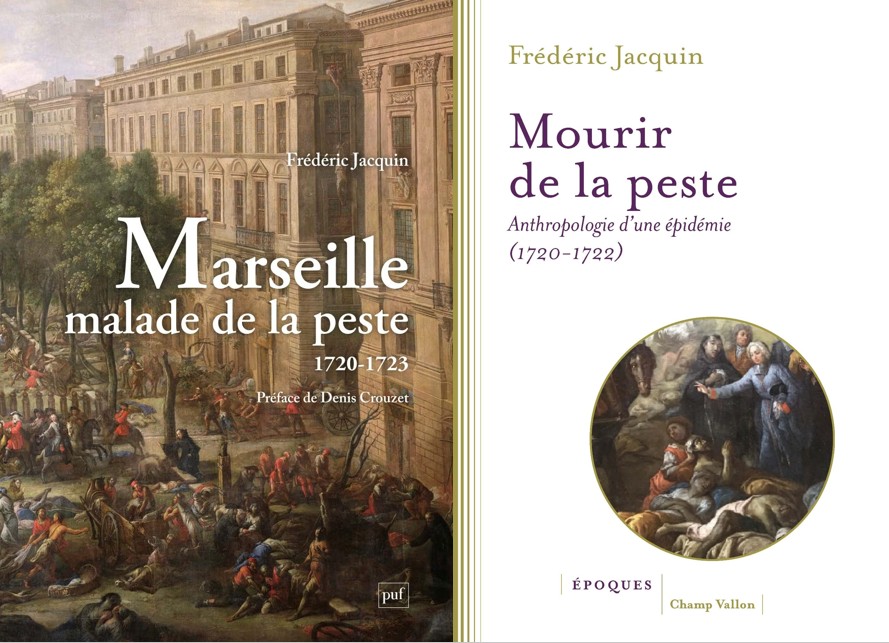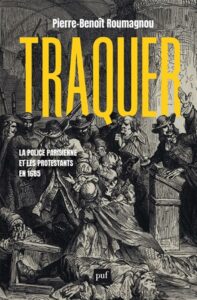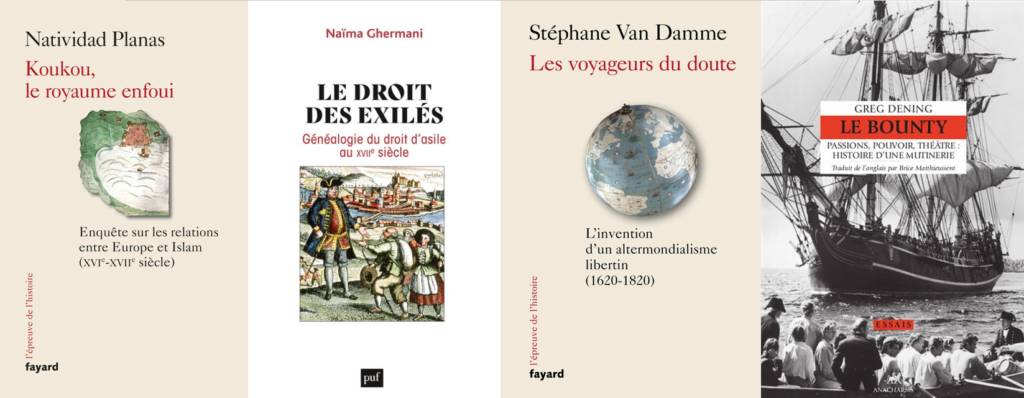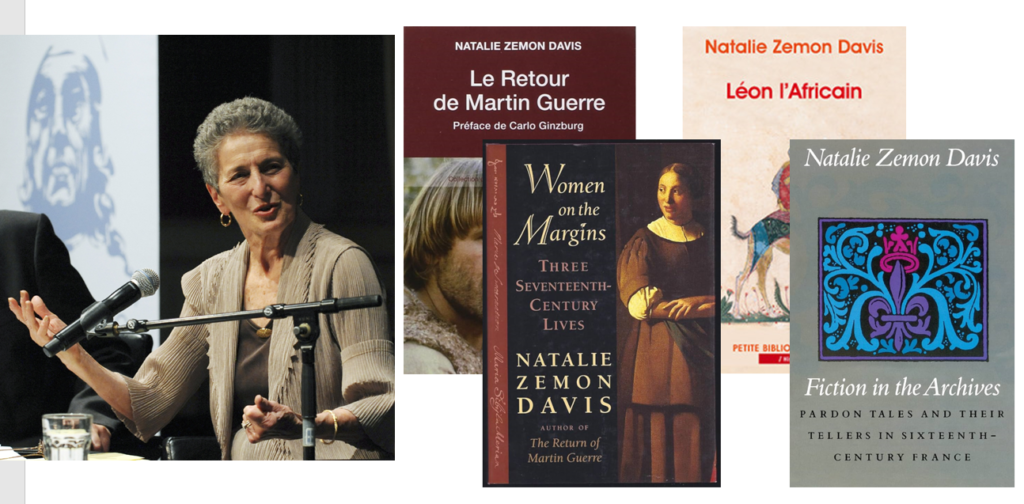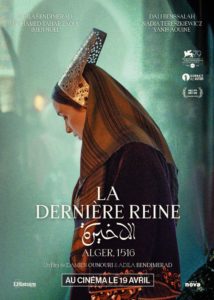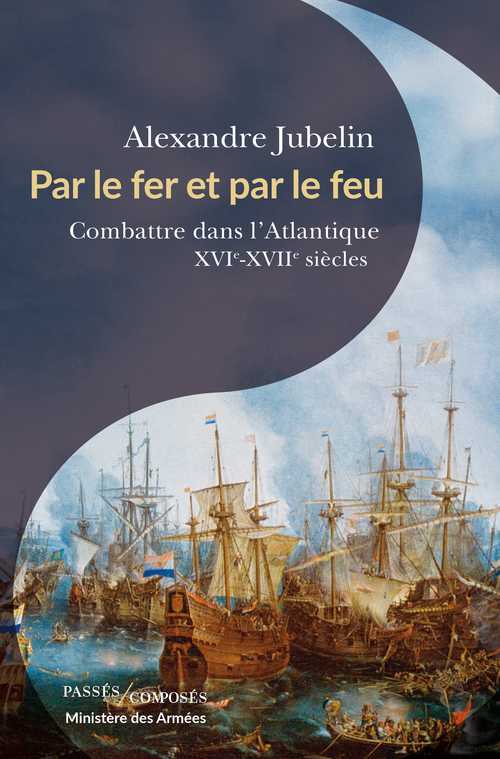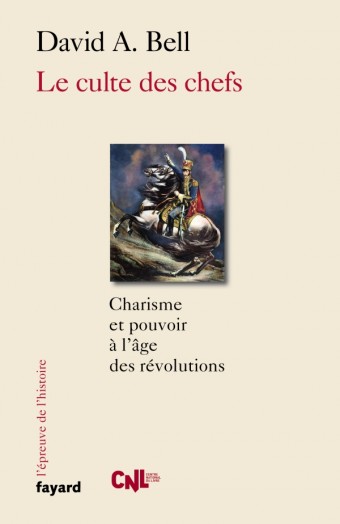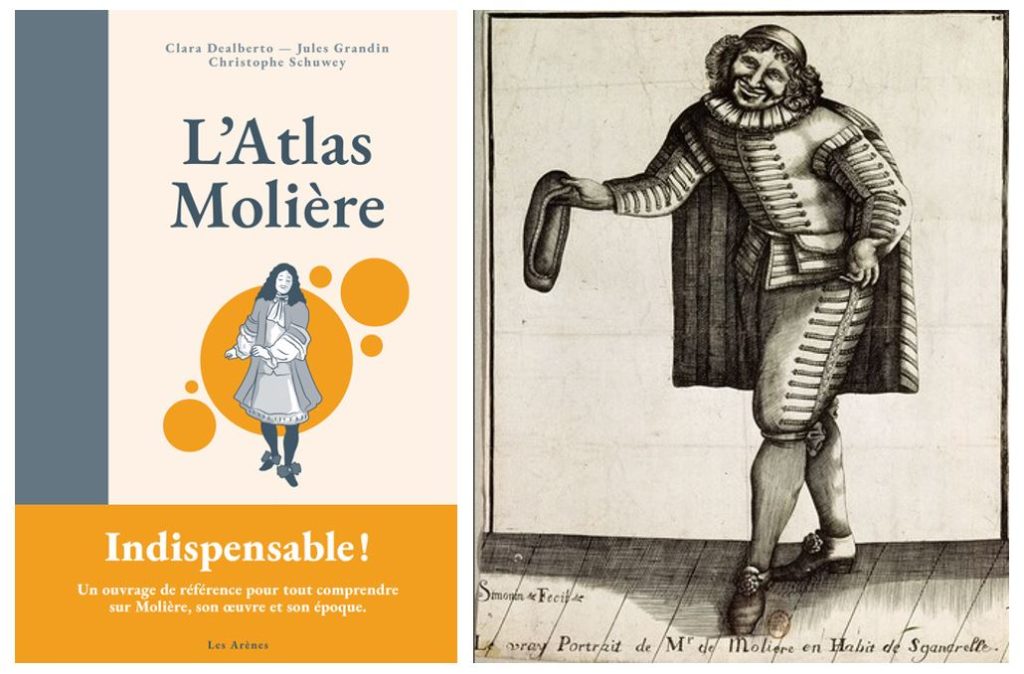L’invité : Frédéric Jacquin, enseignant, docteur en histoire moderne
- Marseille malade de la peste (1720‑1723). Le Journal historique du père Paul Giraud (1720‑1723), suivi de La Relation de la peste de Pierre-Honoré Roux (1720‑1722), Paris, PUF, 2023.
- Mourir de la peste. Anthropologie d’une épidémie, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2025.
La discussion :
- Une catastrophe évitable (00:00)
- Une épidémie interprétée au prisme du christianisme mais qui bouleverse les rites funéraires (13:15)
- Les « corbeaux » et la société urbaine face à la peste (19:00)
- Bruits et odeurs d’une ville empestée (23:00)
- Le sort des pestiférés, et leur isolement (26:15)
- Réponses sanitaires et surtout sécuritaires des autorités (33:00)
- Lendemains de peste (38:00)
Le conseil de lecture : Denis Crouzet, Paris criminel 1572, Paris, Les Belles-Lettres, 2024.
Merci à Thibaud Auzépy, Thibaud Delamare et Alexandre Jubelin pour leurs lectures des textes d’époque.
Télécharger la transcription de l’épisode : https://transcripts.blubrry.com/parolesdhistoire/142757704-51098.srt
Pour supprimer le minutage de la transcription utiliser cet outil en ligne : https://anatolt.ru/t/del-timestamp-srt.html