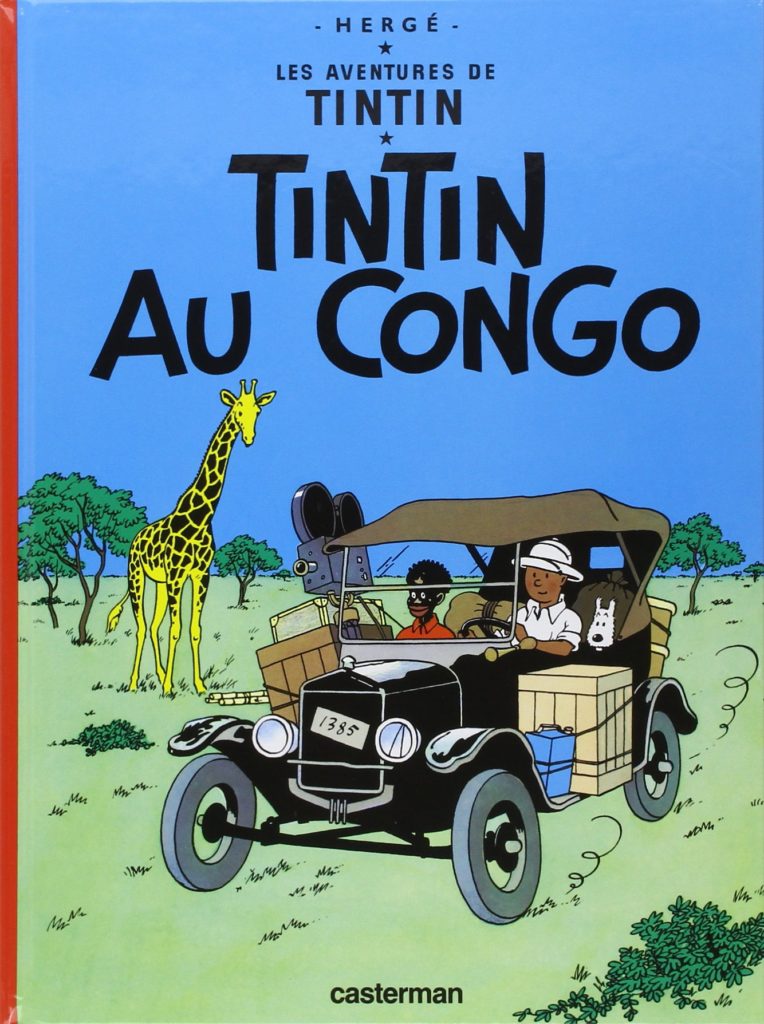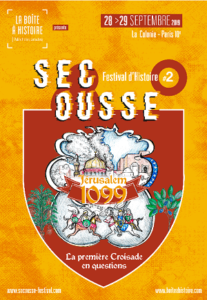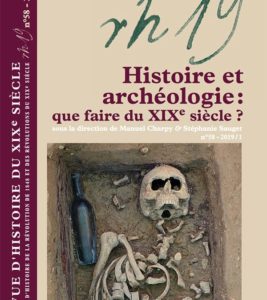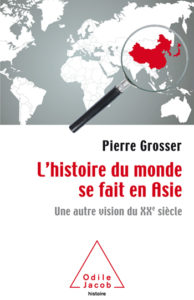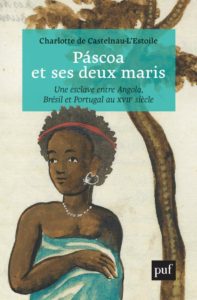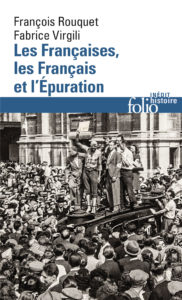Podcast: Play in new window | Download
S'abonner : Apple Podcasts | Spotify | Android | Deezer | RSS | More
 Depuis mai 2020, à travers le monde, les statues et monuments ayant un lien avec le passé colonial et esclavagiste sont contestées et parfois renversées. Une irruption des enjeux mémoriels dans l’espace public qui fait l’objet de cinq émissions du podcast:
Depuis mai 2020, à travers le monde, les statues et monuments ayant un lien avec le passé colonial et esclavagiste sont contestées et parfois renversées. Une irruption des enjeux mémoriels dans l’espace public qui fait l’objet de cinq émissions du podcast:
1. Tempête mémorielle dans l’espace public
2. Aux sources de l’iconoclasme
3. Antilles, États-Unis, les épicentres de la contestation
4. Tour du monde des statues renversées
La liste des textes, interviews et articles sur les statues contestées est à consulter ici, ainsi que cette liste établie par Liesbeth Corens
Liste des intervenantes et des intervenants :
- Robert ALDRICH, professeur à l’Université de Sydney (épisodes 1, 2 , 4 et 5)
- Felicity BODENSTEIN, MCF à Sorbonne Université (épisode 5)
- Audrey CÉLESTINE, MCF en sociologie politique à l’Université de Lille (épisodes 3 et 5)
- Julie DESCHEPPER, (épisodes 2 et 5)
- Armelle ENDERS, professeure à l’Université Paris-8 (épisode 4)
- Urte EVERT, directrice du musée de la citadelle de Spandau à Berlin (épisode 5)
- Emmanuel FUREIX, professeur à l’Université Paris-Est Créteil (épisodes 1, 2 et 5)
- Sarah GENSBURGER, sociologue, chargée de recherche au CNRS (épisodes 1, 2 et 5)
- Annie GÉRIN, professeure à l’Université Concordia (épisodes 2 et 4)
- Cécile GONÇALVES, docteure en études politiques (épisode 4)
- Benoît HENRIET, professeur à la Vrije Universiteit Brussel (épisodes 1, 4 et 5)
- Silyane LARCHER, politiste, chargée de recherche au CNRS (épisodes 2, 3 et 5)
- Itay LOTEM, lecturer à l’Université de Westminster (épisodes 1, 4 et 5)
- Guillaume MAZEAU, MCF à l’Université Paris-I (épisode 2)
- Mikaa MERED, enseignant et conférencier en géopolitique (épisode 4)
- Nicolas OFFENSTADT, MCF à l’Université Paris-I (épisodes 1, 2 et 5)
- Emmanuelle PEREZ TISSERANT, MCF à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès (épisode 3)
- Michael ROY, MCF en études américaines à l’Université Paris-Nanterre (épisode 3)
- Jennifer SESSIONS, associate professor à l’Université de Virginie (épisodes 1 et 4)
- Dominique TAFFIN, conservatrice générale du patrimoine, directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (épisodes 3 et 5)
- Benoît VAILLOT, doctorant à l’Université de Strasbourg et à l’Institut Universitaire Européen de Florence (épisode 2)